Quoique le COVID-19 ait pris par surprise les gouvernements dans le monde entier, c’était un accident qui ne demandait qu’à se produire. De même que le chaos économique et social provoqué par la pandémie a été préparé dans la dernière période, le capitalisme a depuis longtemps jeté les bases d’un désastre sanitaire de cette ampleur.
Les apologistes du capitalisme prônent la supériorité du marché sur la planification économique. Mais la production pharmaceutique et la « recherche et développement » (R&D) sont complètement handicapées par les forces du marché. Durant les deux dernières décennies, il y a eu sur le plan international plusieurs attaques virales qui ont coûté des milliers de vies (Sars-CoV-1, Mers, Zika, Ebola, etc.). Jusqu’à aujourd’hui, seul un vaccin (pour Ebola) est passé sur le marché.
Le coronavirus n’est pas une menace inconnue. Le SARS fait partie de la famille des coronavirus. Le gouvernement des Etats-Unis a dépensé plus de 615 millions de dollars pour la recherche sur le coronavirus durant les vingt dernières années. Toutefois, les scientifiques sont à la traîne. Jason Schwartz, professeur à l’Ecole de Santé Publique de Yale, a rapporté ceci dans la revue Atlantic : « si nous n’avions pas mis de côté le programme de recherche vaccinale sur le SARS [en 2004], nous aurions eu beaucoup plus de résultats sur ce travail fondamental, résultats que nous aurions pu appliquer à ce nouveau virus étroitement apparenté ». Le modèle commercial « coût élevé-retour élevé » de la R&D médicale destinée au profit s’applique mal aux pandémies actives, parce que quand la crise se termine, le marché s’assèche immédiatement, ce qui a pour résultat que le financement est supprimé et la recherche mise en sommeil.
Cependant, on a récemment annoncé que l’Institut américain des Maladies allergiques et infectieuses (NIAID) a reçu une première proposition pour un vaccin contre le COVID-19. Le vaccin a été produit par NIAID en partenariat avec une compagnie nommée Moderna, fondée sur la recherche de plusieurs universités aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. Le processus de certification est accéléré, ce qui signifie que des essais pourraient commencer dès le mois prochain. Mais il faudra au moins un an avant qu’un tel vaccin puisse être massivement produit, et d’ici là la pandémie pourrait avoir flambé – emportant avec elle, potentiellement, des millions de vies. Et même alors, NIAID aura besoin d’une autre grande entreprise pharmaceutique pour assurer la tâche d’industrialiser le vaccin. Cela est dû au fait que les grandes entreprises de ce type, comme Pfizer, Novartis, etc., ont la mainmise sur les matières premières et ont des brevets sur les processus de fabrication des vaccins. Jusqu’ici, ces gros bonnets de la pharmacie manifestent peu d’intérêt. Et cela en dépit du fait que le Secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, ait déclaré que tout industriel privé serait autorisé à fixer des prix « raisonnables » pour ses produits. « Nous avons besoin de l’investissement du secteur privé », a-t-il déclaré, « le contrôle des prix ne doit pas nous arrêter ». Pour des millions de gens, ce vaccin pourrait être salutaire – mais les capitalistes n’investiront pas s’il n’y a de profits à en retirer.
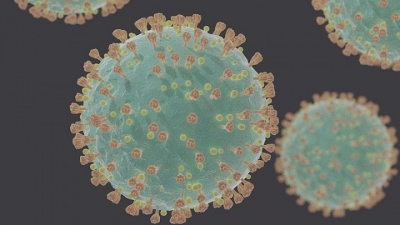
La majorité du financement de la R&D pharmaceutique provient du secteur privé, ce qui représente 67 % d’un total de 194,2 milliards de dollars investis dans le secteur de la santé aux Etats-Unis en 2018, en comparaison des 22 % qui proviennent d’organismes fédéraux et 8 % d’instituts de recherche universitaires. Les compagnies pharmaceutiques utilisent ces coûts élevés de R&D pour justifier l’augmentation des prix des médicaments plus anciens et des génériques, et cela au point que des produits aussi essentiels que l’insuline peuvent coûter de 25 à 100 dollars pour une ampoule aux Etats-Unis. En 2015, le président de Turing Pharmaceuticals, Martin Shkreli, suscita un scandale en augmentant le prix de Daraprim (un médicament utilisé dans le traitement des troubles liés au Sida) de 13,5 à 750 dollars par pilule. En dépit de l’excuse selon laquelle de telles aubaines sont réinvesties dans le développement des médicaments, la grande majorité des nouveaux produits est financée par la recherche d’Etat ou subventionnée par l’Etat : cela inclut le nouveau vaccin expérimental pour le COVID-19. Plutôt que de faire progresser la recherche médicale et l’innovation, les entreprises pharmaceutiques privées utilisent la plus grande part de leur pouvoir financier à accumuler des brevets sur des médicaments développés à l’aide de l’argent public, à produire à des prix gonflés des dérivés de médicaments déjà amortis, et à produire en masse des médicaments de confort comme le Viagra. En pratiquant ainsi (et en bénéficiant, dans les années 1990, d’une libéralisation des lois anti-monopole), les entreprises pharmaceutiques sont devenues l’industrie légale à la croissance la plus rapide et aux profits les plus élevés sur terre au tournant du millénaire, amassant 1200 milliards de dollars en 2018.
Avec ce flot d’argent facile, les compagnies pharmaceutiques privées ont un faible intérêt à développer de nouveaux vaccins de leur propre initiative – en particulier pour des épidémies actives. Le mécanisme grâce auquel les virus vivent et se propagent est mal compris par la science, des maladies comme le coronavirus donnant très vite de nouvelles souches. Le développement d’un vaccin est un processus difficile, cher, qui prend du temps, et pour lequel les retours financiers ne sont jamais garantis. Trevor Jones, directeur de l’Association Britannique de l’Industrie Pharmaceutique, a déclaré qu’il en coûte 500 millions de dollars pour la recherche et le développement d’un nouveau médicament, et que les entreprises escomptent le retour sur investissement en l’espace des trois à cinq premières années de vente. Le dernier « vaccin à grand succès » produit par le secteur privé était le Gardasil de Merck, pour un usage contre le papillomavirus, qui sortit en 2006 après un cycle de développement de 20 ans. Forbes s’est fait l’écho récemment de la « crise de l’innovation » de cette industrie, soulignant les principales contradictions au cœur de ce secteur : les profits augmentent, mais le nombre de nouveaux médicaments est en baisse :
« La productivité déclinante semble un étrange problème dans un secteur qui amasse plus d’argent qu’il n’en peut investir, profite d’une demande sans limites et dispose de la capacité monopolistique de fixer les prix. Mais la pharmacie n’est pas un commerce “normal”. Chaque nouveau médicament, chaque essai clinique est une expérimentation. Le développement est intrinsèquement imprévisible, ce que reflète un taux de succès de 2 %… [Un] examen des variations de valeur des médicaments et des revenus industriels entre 1995 et 2014 n’a pas montré la baisse attendue. Le problème de productivité ne provient pas des obstacles à la production [mais] des coûts croissants ».
En bref, développer de nouveaux médicaments constitue un investissement trop risqué et un profit insuffisamment assuré, ce qui a pour résultat que les industries pharmaceutiques consacrent leurs ressources à des pistes plus lucratives. Dans le même temps, l’industrie pharmaceutique privée use de son pouvoir oligarchique pour empêcher le développement et la fabrication de nouveaux médicaments par d’autres, y compris l’Etat. Résultat : tandis que les capitalistes accumulent, le marché nous laisse dépourvus pour affronter des crises comme celle du COVID-19.
Alors que le secteur privé traîne les pieds, de nombreuses tentatives ont été faites pour mettre en place une R&D médicale gérée par l’Etat. Mais alors que la recherche publique a vu son financement augmenter dans les pays capitalistes avancés ces dernières années, elle ne constitue encore qu’environ 5 % seulement de la dépense totale aux Etats-Unis par exemple. En revanche, la dépense militaire s’élève à 54 %. Et l’immense pouvoir de l’oligarchie pharmaceutique signifie qu’elle peut plier les organismes gouvernementaux à sa volonté s’ils entrent en conflit sur un point essentiel. L’Etat ne dicte pas sa conduite au Capital ; c’est l’inverse.
La dernière fois que le gouvernement américain a approuvé une campagne nationale de vaccination, c’était pour la grippe porcine (H1N1) en 1976. Quatre firmes pharmaceutiques – Merck’s Sharp & Dohme, Merrell, Wyeth et Parke-Davis – refusèrent de vendre au gouvernement les 100 millions de doses de vaccin qu’elles avaient produites jusqu’à ce qu’elles obtiennent une pleine assurance de responsabilité et un profit garanti. Et peu avant le COVID-19, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) leva 750 milliards pour accélérer le développement de vaccins pour traiter de nouvelles épidémies, avec le soutien de pays comme le Japon, l’Allemagne, le Canada, etc. Mais les compagnies privées participant au comité consultatif scientifique de la CEPI (incluant Johnson&Johnson, Pfizer et Takeda) ont forcé l’organisation à renoncer, au principe que « tous les pays auraient un accès égal et à prix raisonnable aux vaccins financés par la CEPI ». Cela assurait aux capitalistes de retirer un bon profit sur n’importe quel vaccin développé grâce à ce fonds, et sur n’importe quel marché étranger.
Deux des plus grands obstacles au progrès dans le domaine de la recherche médicale sont aussi les deux plus grandes entraves au développement de la société capitaliste en général : l’Etat nation et la propriété privée. La montée des tendances protectionnistes dans le monde entier affecte aussi le marché des médicaments, avec des nations cachant jalousement les résultats de leur recherche pharmaceutique récente – la recherche publique aussi bien que la recherche privée. Durant cette crise du COVID-19, ces tendances se sont accélérées. Les dirigeants mondiaux s’abritent derrière leurs frontières, refusant de partager des ressources essentielles pour combattre la pandémie. Le président serbe dénonçait récemment le « conte de fées » de la solidarité européenne, au regard des lois de l’Union Européenne qui empêchent le mouvement des médecins et du matériel médical essentiel vers des pays hors de l’espace Schengen. Il a donc annoncé que les frontières de la Serbie seraient fermées aux « étrangers ». En réalité, la solidarité entre les pays de l’espace Schengen s’est aussi effondrée, avec l’Allemagne d’abord bannissant l’exportation de masques, pourtant désespérément nécessaires, vers des pays comme l’Italie. 21 des 26 des Etats Schengen ont maintenant fermé leurs frontières, faisant peser une menace existentielle sur l’Union Européenne. Cette folie est le produit d’un système sénile, qui s’est déchiré en une guerre intestine au moment où l’unité était on ne peut plus nécessaire. Les virus ne connaissent pas de frontières, et le manque de coordination internationale handicape sévèrement notre capacité à répondre à la pandémie.

Récemment, des étudiants de l’Université de Sheffield ont séquencé entièrement le génome du coronavirus à partir de patients britanniques et sont censés mettre cette recherche à la disposition du public. C’est un succès remarquable que l’on doit à une académie financée par l’Etat. Cependant, il y a maintenant une course pour développer un vaccin fondé sur cette recherche et, de la part de différents gouvernements, pour s’en assurer l’exclusivité. Premier sur la liste le président des Etats-Unis Donald Trump qui, suivant sa devise « l’Amérique d’abord », a offert à la compagnie biopharmaceutique allemande CureVac « des sommes d’argent considérables » pour des droits exclusifs sur un vaccin COVID-19 et ses agents antiviraux. Le gouvernement allemand a apparemment répondu à cette tentative par une contre-proposition. Potentiellement, cela pourrait déclencher une guerre des enchères qui forcerait des millions de gens et les services de santé des Etats à acheter des vaccins au prix fixé par le gagnant.
Dans le cadre d’une économie mondiale planifiée, toutes les ressources de la planète pourraient être concentrées pour développer un traitement efficace et un vaccin contre le COVID-19. Mais les intérêts antagonistes des nations capitalistes empêchent cela. Des tentatives pour surmonter ces antagonismes sur une base capitaliste ont été faites avec peu de succès. Par exemple, l’OMS met en œuvre le Programme d’alerte sur la grippe pandémique, qui facilite le partage de la recherche entre les nations. Mais il s’applique seulement à la grippe et à aucune autre maladie infectieuse potentiellement pandémique, à cause de la pression de l’industrie et des gouvernements. Assurément, l’OMS elle-même n’est que l’ombre de ses objectifs très élevés. Son financement a été réduit de moitié par l’administration Trump, en proie à des rumeurs de corruption et elle a été supplantée par la Banque Mondiale à titre de plus gros financeur de la santé publique au niveau mondial. Des organismes similaires comme les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont vu aussi ces dernières années leurs budgets sacrifiés, victimes de la tendance protectionniste sur les marchés mondiaux.
En outre, les compagnies privées du secteur médical considèrent leurs produits (qu’elles les aient effectivement développés ou seulement acheté leurs brevets) comme leur propriété privée : considérés pour leur potentiel sur le marché et non pour leur capacité de soigner les gens. Récemment, une compagnie privée a menacé d’action en justice deux volontaires qui étaient en train de produire par imprimante 3-D des valves pour les respirateurs, les vendant pour 1 dollar au lieu de 11 000 au prix du marché. Ce genre d’avarice du secteur privé se retrouve sur l’ensemble du marché pharmaceutique international. Par exemple, l’Accord de 1994 sur les Droits intellectuels garantit la protection de la propriété intellectuelle à toutes les entreprises, y compris les firmes pharmaceutiques, lorsqu’elles vendent leurs produits à n’importe quel pays de l’OMC. Cela se révèle problématique pour les pays les plus pauvres, où des médicaments essentiels sont la propriété intellectuelle des compagnies privées, dont les prix exorbitants sont trop élevés pour ces marchés, compagnies privées qui s’opposent aux tentatives de produire sur place des dérivés moins chers. En réponse à ce problème, en 2001 (à l’initiative de l’OMS), la Déclaration de Doha sur la propriété intellectuelle et la santé publique – à laquelle ont souscrit tous les Etats membres de l’OMS – a affirmé que la santé publique devrait toujours prendre le pas sur le respect des droits à la propriété. Cependant, selon Oxfam en 2019 : « les pays riches et les compagnies pharmaceutiques ont ignoré la Déclaration de Doha et poursuivi un programme agressif pour assujettir le monde en voie de développement à une protection encore plus stricte de la propriété intellectuelle, à travers des accords de libre-échange et une pression unilatérale ». En bref, les pays puissants écraseront toujours les faibles, et les droits de la propriété privée des capitalistes l’emporteront toujours sur le besoin humain.
Une récente déclaration du gouvernement britannique a exposé incidemment l’incapacité du prétendu libre marché à traiter cette pandémie. Le gouvernement conservateur a interdit l’exportation parallèle de 80 médicaments (y compris un antirétroviral, l’adrénaline et la morphine), à cause de la spéculation des compagnies privées, qui étaient en train d’essayer d’acheter ces médicaments à bas prix en Grande-Bretagne pour les stocker et les vendre ensuite à prix gonflé à l’étranger. Cela n’a pas été interdit parce qu’éthiquement inacceptable, mais parce que le gouvernement avait peur que cela n’« aggrave les problèmes d’approvisionnement ». Il a aussi transpiré que la firme américaine Rising Pharmaceuticals a augmenté le prix de la chloroquine (un anti-malaria qui est testé contre le COVID-19) le 23 janvier, quand l’ampleur de l’épidémie en Chine est devenue manifeste. Le médicament grimpa de 97,86 % à 7,66 $ le comprimé de 250 mg et 19,88 $ celui de 500 mg. Bien que la violente réaction de l’opinion l’ait conduite à revenir rapidement au prix « normal » du marché, Rising a d’abord été mise à l’amende pour manipulation des prix et il est clair que la compagnie entendait exploiter la souffrance de millions de gens pour bénéficier d’une aubaine. Ce ne sera pas la dernière fois qu’une compagnie cherche à gagner de l’argent facile sur la pandémie du coronavirus.
Il faut comparer cela avec la production et la distribution de l’Interféron alfa2b par Cuba, développé en 1986 par l’entreprise d’Etat BioCubaFarma en collaboration avec la Chine. Ce médicament, qui peut aider à stopper certains symptômes du coronavirus, a déjà été testé positivement sur 1500 patients en Chine. Cuba a expédié l’Interféron en grande quantité à des pays gravement atteints comme l’Italie. Des équipes de médecins cubains ont aussi été envoyées à des douzaines de pays pour aider à combattre l’épidémie. C’est un témoignage clair en faveur de la supériorité d’une économie planifiée qu’une petite île des Caraïbes puisse produire un traitement effectif pour une maladie qui résiste aux plus grands efforts des pays capitalistes les plus puissants du monde, et puisse envoyer gratuitement une aide médicale à ceux qui en ont besoin. De la même façon, tandis que les compagnies pharmaceutiques visant le profit ont abandonné la recherche dans des conditions difficiles comme celles de la maladie d’Alzheimer à cause de son manque de rentabilité, la recherche médicale d’Etat cubaine a effectué des percées enthousiasmantes à la fois contre Alzheimer et contre le VIH. Il va sans dire que l’embargo imposé à Cuba par la volonté des Etats-Unis constituera un obstacle pour que n’importe lequel de ces traitements salutaires puisse atteindre les peuples qui en ont besoin, et qu’il y aura des conséquences sur les partenaires commerciaux des Etats-Unis qui les accepteraient.
Les limitations du système capitaliste impliquent que la recherche médicale sur les vaccins pour des maladies mortelles est restée stagnante pour l’essentiel depuis les années soixante. L’humanité est de plus en plus vulnérable aux épidémies mondiales (pour des raisons qui seront expliquées plus loin), et nos armes pour y résister sont en train de devenir obsolètes. L’industrie pharmaceutique privatise les profits de ce secteur essentiel, mais elle socialise les risques. Et les gouvernements lui facilitent la tâche. Un chercheur en maladies infectieuses interrogé dans le New York Times déclarait il y a peu : « qu’est-ce qui importe le plus aux compagnies pharmaceutiques ? Garder les secrets commerciaux et améliorer le résultat financier ou bien prendre la première place pour endiguer l’épidémie de COVID-19 ? » La réponse est claire comme le jour. Une crise comme la pandémie actuelle n’offre pas de meilleur argument pour mettre ces parasites improductifs sous contrôle démocratique afin que leurs immenses ressources puissent être employées à bon usage.
Jusqu’ici, le COVID-19 a à peine concerné les pays les moins développés. Les premiers cas confirmés ont été récemment rapportés en Somalie et en Tanzanie. Un autre était détecté dans la bande de Gaza. Le virus va inévitablement se répandre, et quand il le fera, les effets seront catastrophiques. Comment un pays comme la Somalie – qui dispose à peine d’un gouvernement qui fonctionne, et dont le système de logement et le système sanitaire sont dans un état déplorable – pourrait-il mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale ou financer les salaires perdus ? Comment son infrastructure médicale pourra-t-elle faire face à des milliers de patients infectés ? Et en dehors de ces pays pauvres, qu’arrivera-t-il quand seront infectés les milliers de réfugiés du Moyen-Orient vivant dans des tentes dans des camps de migrants en Europe ? La réponse est évidente. Il n’y aura pas de confinement, il n’y aura pas de réponse médicale concertée. Les gens seront livrés à leur propre sort. Cette situation n’a rien d’exceptionnel lorsqu’il est question de prévention des maladies dans les pays sous-développés.
Moins de 10 % du financement de la recherche publique est consacré aux maladies qui affectent les 90 % les plus pauvres de la population mondiale. Des maladies mortelles comme le Sida et la tuberculose prospèrent dans les pays pauvres. Des maladies tropicales négligées tuent 500 000 personnes par an dans les pays en développement. Et si les compagnies pharmaceutiques privées voient un maigre stimulant financier à développer des médicaments pour les pays capitalistes avancés, elles n’en voient aucun pour les nations les plus pauvres. Le Dr. Harvey Bale Jr., responsable de la Fédération internationale des industriels de la pharmacie, a déclaré qu’il n’y avait « aucun marché dont on puisse parler dans le monde pauvre ». Le Dr. Bernard Pécoul de Médecins Sans Frontières ajoutait que la course aux profits « se concentre sur 300 à 400 millions de personnes dans les pays riches ». C’est un exemple très clair qui montre à quel point la production pour le profit est en décalage avec les besoins.

Pour donner un exemple, dans les années 90, le génome de la tuberculose a été séquencé. La tuberculose cause de terribles souffrances dans les parties les plus pauvres du monde. En dépit du fait que l’OMS a organisé en 1998 un sommet pour obtenir l’aide des principales compagnies pharmaceutiques pour développer un vaccin et des traitements, aucune de ces compagnies ne désirait s’engager pour un projet qui, envisagé de façon réaliste, ne produirait pas un profit d’au moins 350 millions de dollars par an. Cela aurait requis un coût total de 11 dollars par comprimé et par patient en Afrique subsaharienne, par exemple, alors que dans le même temps ces pays dépensaient moins de 10 dollars par citoyen et par an pour tous les besoins médicaux. Le projet fut abandonné. Et, mis à part le manque d’investissement en R&D, beaucoup de compagnies privées ont abandonné la production de médicaments déjà existants importants pour les pays en voie de développement, dont cinq traitements de la maladie africaine du sommeil, l’aminosidine pour la leishmania, maladie parasitaire, et même le vaccin contre la polio. Loin de faire progresser l’humanité dans le combat contre la maladie, le capitalisme est en fait en train de nous ramener en arrière.
Des organismes internationaux comme l’OMS et le G8 ont tenté de stimuler l’investissement du secteur privé dans les pays pauvres grâce à des subventions pour garantir d’avance les marchés, par le moyen desquelles les pays capitalistes acceptent de couvrir une partie des coûts pour obtenir des vaccins aux prix abordables là où ils sont le plus nécessaires. Parallèlement, l’Administration américaine de la nourriture et des médicaments (FDA) offre des bons échangeables contre des études accélérées pour n’importe quel futur produit aux compagnies qui développent des médicaments efficaces contre des maladies négligées. Mais toutes ces incitations ont échoué, ou bien parce qu’elles ne sont pas assez attrayantes, ou bien parce que les compagnies pharmaceutiques ont trouvé les moyens de contourner le système et de s’enrichir encore plus. Par exemple, en appliquant le système des bons, qu’on vient de mentionner, au Coartem, médicament contre la malaria, Novartis a accumulé un profit supplémentaire de 321 millions de dollars rien qu’en enregistrant son produit auprès de la FDA, alors même qu’il est déjà largement en usage ailleurs.
La seule valeur que les industries privées pharmaceutiques accordent aux pays en voie de développement est qu’ils constituent un laboratoire pour délocaliser les essais cliniques, ce qui représente le premier et seul coût important dans le développement d’un médicament. Ce coût peut être significativement compensé en exploitant des sujets d’expérimentation dans des pays comme l’Inde, où les essais cliniques ont créé un marché prospère. Mieux encore, ces firmes peuvent souvent éviter les formalités administratives comme les normes éthiques et le consentement éclairé, en déménageant ces opérations vers des pays où les règles sont plus lâches, et ainsi transformer des gens désespérés en rats de laboratoire.
Certains pays pauvres ont cherché à compenser les coûts croissants des médicaments en investissant dans leurs propres moyens de fabrication et de distribution, au prix d’une augmentation de leur dette. Néanmoins, ces efforts ont été contrariés par l’Association des industriels du secteur pharmaceutique, qui estime que cela constitue une « violation des droits à un libre marché ». De 2008 à 2018, un Groupe de travail intergouvernemental sur la Santé publique, les Droits de propriété intellectuelle et sur l’innovation (IGWG) a cherché à répondre aux demandes des pays en voie de développement en faveur d’un système mondial de R&D qui reflèterait mieux leurs besoins. Mais ses recommandations ont été totalement ignorées à la fois par les pays impérialistes et l’industrie privée. Le résumé de la situation se trouve dans un rapport accablant d’Oxfam :
« Le manque d’innovation médicale est un problème mondial qui réclame une augmentation significative des ressources, mise en œuvre d’une manière efficace et coordonnée. Le système actuel de R&D sous-utilise les capacités, les savoir-faire et les ressources disponibles dans tous les pays. Les efforts pour améliorer la R&D dans les pays en voie de développement sont fragmentaires, inconstants et incapables de conduire à des changements à grande échelle ».
En dépit des plaintes d’Oxfam et de l’IGWG, on ne peut changer les règles du capitalisme en en appelant à un capitalisme d’une meilleure nature. S’il n’y a pas de marché profitable, il n’y aura pas d’investissement. Les réformes proposées réclameraient une rupture fondamentale avec le système actuel. Naturellement, la recherche sur des traitements susceptibles de sauver des vies pour des maladies qui affectent les pays en développement aurait aussi un impact positif sur le développement de vaccins et de traitements dans les pays capitalistes avancés. Mais le système du marché ne pense qu’à des retours immédiats. La vie humaine est de la petite monnaie.
La maladie sert aussi à maintenir pauvre le monde pauvre. La crise du Sida (dont l’origine réside dans la transmission du primate à l’homme par le biais du marché illégal de viande de brousse, à laquelle des populations désespérées durent recourir à la suite de plusieurs famines successives) a fauché les pays en développement dans les années 80 et 90. Conséquence de cette pandémie : 121 millions de personnes ont aujourd’hui perdu la vie. La Banque Mondiale estimait en 1991 que le sida accaparait plus de 4 % du budget sanitaire de la Tanzanie, 7 % au Malawi, 9 % au Rwanda, 10 au Burundi et 55 en Ouganda. En outre, les épidémies dans les pays pauvres d’Afrique et d’Amérique ont été exacerbées par l’impact des guerres et des coups d’Etat, provoqués par l’intervention impérialiste, et qui mettent à mal les infrastructures de santé de ces pays déjà vulnérables. Les injonctions insultantes de la Banque Mondiale depuis les années 70 pour faire pression sur les pays pauvres afin qu’ils dépensent plus pour la prévention des maladies et les soins ont été rendues vaines à cause de la nécessité pour ces pays de rembourser des dettes énormes à des organismes comme le FMI. L’impérialisme a apporté la ruine à ces pays, non seulement à travers le colonialisme, l’exploitation et la guerre, mais aussi la maladie. Maintenant, ils sont pratiquement sans défense contre les urgences comme la pandémie du COVID-19.
Alors que ses origines exactes ne sont pas claires, on pense que le COVID-19 est passé de l’animal à l’homme à la fin de l’année dernière à Wuhan, la capitale du Hubei en Chine, et qu’il s’est ensuite répandu grâce aux transports nationaux et internationaux durant le Nouvel An chinois. C’est la même situation que pour l’épidémie de SARS en 2003, qui résultait d’une transmission d’une souche mutée de coronavirus dans un marché d’animaux vivants dans la province de Canton. Aucune de ces deux épidémies n’était un événement « naturel ». Bien plutôt, ces épidémies étaient l’inévitable conséquence d’une production capitaliste rapace, qui est en train de créer un terrain fertile pour permettre à des maladies potentiellement mortelles de se développer dans des populations animales et de s’étendre aux êtres humains.
La fréquence accrue des pandémies dans les années antérieures peut être en partie expliquée par la destruction capitaliste de l’environnement. Depuis 1940, sont apparus des centaines de microbes pathogènes dans de nouveaux territoires, y compris le VIH, Ebola en Afrique, Zika dans les Amériques, etc. Plus des deux tiers de ces microbes proviennent du milieu sauvage plutôt que d’animaux domestiques. La déforestation du fait de l’exploitation forestière, l’expansion urbaine, la construction de routes et les mines détruisent l’habitat des espèces sauvages et accroissent leurs contacts avec les établissements humains, ce qui offre plus d’occasions pour les microbes, qui vivent sans faire de mal dans les organismes sauvages, de passer dans les nôtres. L’écologiste des maladies Thomas Gillespie, interrogé dans Scientific American, a déclaré : « Je ne suis pas du tout surpris de l’épidémie de coronavirus. La majorité des agents pathogènes [dans les organismes des animaux sauvages] reste encore à découvrir. Nous sommes au sommet de l’iceberg ».

Par exemple, l’épidémie d’Ebola, en 2017, provenait d’espèces de chauve-souris forcées, à cause de la déforestation, de percher dans les arbres des fermes et des arrière-cours. Ces animaux deviennent porteurs de souches transmissibles à l’homme et transmises à cause de contacts répétés qui, ou bien par morsure, ou bien par matière fécale, ou bien par la consommation de viande vendue dans des marchés de « frais » informels – dans lesquels des espèces qui ne se rencontreraient jamais naturellement sont encagées côte à côte. Ces marchés sont une source de nourriture essentielle pour les gens pauvres en Asie et en Afrique ; cependant, selon Gillespie, « ils sont un milieu extrêmement favorable pour la transmission d’agents pathogènes d’une espèce à l’autre. A chaque fois qu’on a de nouvelles interactions avec une série d’espèces dans un même lieu, qu’il s’agisse d’un environnement naturel, comme une forêt, ou d’un marché d’animaux vivants, on peut avoir un phénomène de transmission ». C’est exactement ce qui s’est passé pour le coronavirus mutant qui a causé l’épidémie de SARS, et possiblement celle du COVID-19. Une hypothèse est que le virus est passé d’une chauve-souris ou d’un pangolin sur un marché à une première victime humaine, un homme de 55 ans.
Néanmoins, ce n’est qu’un des scénarios dans lesquels de dangereux agents pathogènes peuvent provenir des animaux. Dans les fermes-usines, des centaines de milliers d’individus sont entassés, ce qui crée un environnement idéal pour la transformation des microbes en agents pathogènes létaux. La grippe aviaire, par exemple, a son origine chez les oiseaux aquatiques sauvages. Mais quand elle atteint les fermes industrielles pour poulets, elle ravage la population et mute rapidement pour devenir plus virulente. C’est ce qui a produit le redouté H5N1, qui peut infecter et tuer les humains. En outre, des essais pour maximiser la production issue d’un animal particulier ont eu pour résultat de multiplier des élevages en monoculture. Cela crée un environnement idéal pour l’évolution de dangereux virus. La grippe porcine prend son origine dans la monoculture des porcs, par exemple – même si l’industrie porcine a fait campagne auprès de l’OMS pour renommer la grippe porcine en lui donnant son nom scientifique de H1N1 pour détourner l’attention de son origine. Certains savants ont émis l’hypothèse que la monoculture porcine pourrait avoir donné naissance au nouveau coronavirus.
Ces questions affectent l’agrobusiness dans tous les pays avancés, et les activités de production alimentaire aux Etats-Unis et en Europe ont servi de point de départ pour les grippes H5N2 et H5Nx, les deux étant minimisées par les responsables de la santé publique américaine. Cependant, ce n’est pas un hasard si nombre d’épidémies sérieuses ont démarré en Chine ces dernières années. Là aussi la production capitaliste est à blâmer.
Le rapide développement de l’économie chinoise sur une base capitaliste a construit un château de cartes épidémiologique dans ce pays. Le livre de Rob Wallace, Big farms make big flu [A grande ferme, grande grippe], enquête sur l’émergence de la grippe aviaire en Chine. Il explique comment, dans les années 1980 et 1990, le pays a modernisé et consolidé son industrie agroalimentaire dans des provinces comme celle de Canton, où le premier cas de H1N1 a été rapporté en 1997. Des compagnies étrangères comme Charoen Pokphand (CP) ont été invitées à s’implanter à Canton, introduisant des activités intégrées verticalement où les animaux, leur nourriture et les usines où elles sont fabriquées étaient tous fournis par la même société. Il en a résulté une explosion du nombre de canards et de poulets produits chaque année. Les techniques d’élevage intensif à l’américaine (avec une réglementation encore plus relâchée) ont été introduites pour satisfaire la demande du marché et maximiser les profits, et cette concurrence imbattable a dévasté la production agricole rurale des communautés paysannes, ce qui a conduit à une migration interne massive vers ces provinces. Cela a mis l’énorme monoculture de volailles en contact rapproché avec des populations humaines densément entassées. Le Hubei est en Chine la sixième plus grande région productrice de volailles, avec une population de 58,5 millions d’habitants. Peu importe comment a commencé le COVID-19, au Hubei la bombe à retardement de la maladie était enclenchée.

L’immense pouvoir économique de sociétés comme CP (qui produit maintenant 600 millions des 2,2 milliards de poulets vendus annuellement en Chine) se traduit en un immense pouvoir politique en Asie. Par exemple, CP était un grand supporter du tycoon des télécommunications Thaksin Shinawatra, le Premier ministre de la Thaïlande lors de la première attaque de grippe aviaire ; lequel ministre promettait de conduire le pays « comme une entreprise », au nom de quoi étaient menées des attaques massives contre les droits ouvriers et une libéralisation agressive de l’économie thaïe. Quand l’épidémie a éclaté en Thaïlande, Shinawatra a joué un rôle actif pour bloquer les efforts visant à endiguer la propagation de la grippe aviaire. Les usines de conditionnement des poulets ont en réalité intensifié leur production ; des syndicalistes rapportaient qu’une usine continuait de produire en masse entre 90 et 130 mille poulets chaque jour, en dépit du fait qu’il était évident que les animaux étaient malades. Shinawatra et ses ministres s’exhibaient à la télé en train de manger du poulet pour montrer leur confiance, mais en coulisses, CP et d’autres industriels agroalimentaires s’entendaient avec le gouvernement pour rembourser les éleveurs en contrat avec les entreprises afin de les calmer au sujet de leurs animaux infectés. En retour, le gouvernement fournissait secrètement des vaccins aux éleveurs appartenant aux compagnies, tandis que les éleveurs les plus pauvres étaient maintenus dans l’ignorance, ce qui les mettait en danger, eux-mêmes et leurs animaux. Quand le Japon a interdit la volaille provenant de Chine durant la crise, les usines thaïes de CP se sont emparées du créneau, avec pour résultat que la compagnie a même tiré un profit accru d’une épidémie qui était largement fabriquée par elle !
En bref, la pression massive exercée sur les animaux et l’environnement par la production capitaliste a contribué à un scénario très dangereux, dans lequel des agents pathogènes communicables à l’homme sont en train de se développer et de se répandre à un rythme accéléré. Cela rappelle les mots d’Engels dans la Dialectique de la nature : « Ne nous flattons pas excessivement des victoires de l’humanité sur la nature. Pour chacune de ces victoires, la nature prend sa revanche sur nous. Chaque victoire, il est vrai, apporte dans un premier temps les résultats attendus, mais en un second et un troisième temps elle a des effets tout à fait différents et imprévus qui annulent trop souvent le premier ».
Nulle part ce sentiment n’est plus vrai qu’à propos des agents pathogènes qui naissent dans les élevages industriels. Il n’y a aucune raison que la monoculture des animaux, bourrés d’antibiotiques, entassés côte à côte dans des usines infernales, ne devienne le sol nourricier de la maladie. Dans une économie planifiée rationnellement, tous ces processus pourraient être rendus aussi efficaces, humains et sains que possible, sans avoir à satisfaire l’appétit de profit des capitalistes.
En 1994, la journaliste Laurie Garrett, prix Pulitzer, écrivit The coming plague [la peste qui vient] : newly emerging diseases in a world out of balance [les maladies nouvellement émergentes dans un monde qui a perdu son équilibre]. Cet ouvrage était suivi en 2001 par Betrayal of trust [Trahison de la confiance] : the collapse of global public health [l’effondrement de la santé publique mondiale]. Dans ces deux livres, elle expliquait que « la perturbation par l’homme de l’environnement mondial, couplée à des comportements qui facilitent la diffusion des microbes aux différents peuples et des animaux vers l’homme, garantit une vague mondiale d’épidémies, et même une énorme pandémie. [Ces] épidémies sont favorisées et encouragées par des systèmes de santé ineptes, le comportement humain et l’absence complète de support politique et financier pour un état de préparation en vue de combattre les maladies, partout dans le monde ». Quoiqu’elle ne l’ait pas exprimé en ces termes, les livres en question étaient une accusation accablante du capitalisme et de ses effets corrosifs sur la santé publique. Les avertissements de Garrett furent corroborés par un rapport du Global Preparedness Monitoring Board qui avertissait : « il y a une menace très réelle d’une pandémie hautement létale se déplaçant très rapidement d’un agent pathogène respiratoire tuant 50 à 80 millions de personnes et anéantissant environ 5 % de l’économie mondiale ».
Le rapport continue : « entre 2011 et 2018, l’OMS a relevé la trace de 1483 événements épidémiques dans 172 pays. Des maladies sujettes à devenir épidémiques comme la grippe, SARS, MERS, Ebola, Zika, la peste, la fièvre jaune et d’autres, sont les avant-coureurs d’une nouvelle ère d’épidémies à fort impact, susceptibles de se propager rapidement, qui sont plus fréquemment détectées et de plus en plus difficiles à gérer… Tout pays sans système de santé de base, sans services publics de santé, sans infrastructure sanitaire et sans mécanismes de contrôle efficaces de l’infection, fera face aux plus grandes pertes, y compris des décès, des déplacements de population et une dévastation économique ».
En d’autres termes, la crise actuelle du COVID-19 fait partie d’une nouvelle ère dans laquelle les pandémies deviendront plus communes. Le monde n’est pas préparé à cela et ce sont les pays les plus pauvres qui vont souffrir le plus. Outre l’émergence de nouveaux agents pathogènes, il y a d’autres menaces à l’horizon, parmi lesquelles des souches microbiennes résistant aux antibiotiques comme le streptocoque et le staphylocoque. Des maladies des XIXe et XXe siècles, comme la tuberculose, sont en train de revenir se venger sur des communautés pauvres comme Harlem à New York – et développent une résistance aux antibiotiques. Dans les années 1990, un rapport de l’Université de Californie prévoyait qu’en 2070 le monde aurait épuisé toutes les options de médicaments antimicrobiens dans la mesure où les virus, les bactéries, les parasites et les champignons auraient développé une résistance complète à l’arsenal pharmaceutique humain. Ce scénario apocalyptique pourrait être évité si davantage était investi dans la recherche pour des vaccins et des traitements alternatifs.

La croissance capitaliste d’après-guerre correspondait à une époque de grand optimisme en matière de santé publique. L’amélioration du logement et de l’assainissement, et la découverte des antibiotiques, signifiaient une augmentation rapide de l’espérance de vie. Au Royaume-Uni, la classe ouvrière revenait d’une guerre victorieuse en exigeant des réformes, parmi lesquelles le National Health Service [Service de Santé National]. En 1995, on constatait que le vaccin contre la polio avait réduit avec succès les cas de maladie en Europe occidentale et en Amérique du Nord de 76 000 en 1955 à 1000 en 1967. En 1978, l’OMS convoquait une réunion des ministres de la Santé de 130 nations à Alma-Ata en URSS, qui publiait un document (« Déclaration d’Alma-Ata ») qui appelait « tous les peuples du monde à atteindre pour l’année 2000 un niveau de santé qui permettrait de mener une vie sociale et économique productive », définissant la santé « comme un état de bien-être physique, mental et social, et pas seulement comme absence de maladie ou d’infirmité », et comme un « droit humain fondamental ». Mais aujourd’hui, loin d’être un droit humain, des soins décents et abordables sont refusés à des millions de gens. Pendant ce temps, des années de sous-investissement et de privatisation ont mis la recherche médicale quasiment à l’arrêt, et les gains démocratiques de la période d’après-guerre ont été effacés.
L’austérité qui a suivi le krach économique de 2008 a effectué une sévère ponction sur la santé publique, dont les conséquences sont maintenant impitoyablement mises au jour par la nouvelle épidémie de coronavirus. Partout, un manque de tests (fabriqués par le privé) rend impossible de rassembler des données exactes sur l’étendue de la pandémie. Les lits d’hôpital sont en nombre insuffisant de façon critique. Des travailleurs de la santé retraités sont amenés à revenir en service. Des pays comme la Grande-Bretagne ont d’abord minimisé le risque présenté par le virus, avant de faire demi-tour et d’imposer un confinement. Le discours initial sur l’« atténuation » et sur « l’aplatissement de la courbe » plutôt que sur la maîtrise de l’épidémie était en partie destiné à éviter de perturber les affaires, mais il était aussi lié au fait que le système de santé ne pouvait supporter le fardeau d’une épidémie qui pouvait durer jusqu’en 2021 et envoyer 8 millions de personnes à l’hôpital. Dans le même temps, la décentralisation et les coupes successives effectuées contre le système de santé italien durant les 30 dernières années ont conduit à des pénuries majeures non pas seulement de respirateurs et de lits, mais même de masques et de gel pour les mains, et cela dans un des pays les plus affectés. Les hôpitaux italiens submergés n’ont pas d’autre possibilité que de choisir qui vivra ou mourra selon l’âge. Les travailleurs de la santé sont complètement exténués, avec des images d’infirmières italiennes s’évanouissant d’épuisement, témoignages d’une situation absolument dramatique. En outre, les patrons, un pays après l’autre, refusent de prendre les mesures de protection appropriées ou de cesser la production à moins d’être forcés de le faire par la grève. Et même là où les gouvernements bourgeois ont accepté de garantir les salaires et de reprendre la propriété de certains secteurs pour sauver le système capitaliste, la classe ouvrière devra inévitablement payer l’addition quand la poussière sera retombée. Le capitalisme n’a pas seulement rendu les épidémies plus probables, mais il a sapé la santé publique au point qu’il est incapable de les affronter.
L’épidémiologiste Larry Brilliant, qui a mené le combat contre la variole, a dit une fois : « les épidémies sont inévitables, mais les pandémies sont optionnelles ». Rien de tout cela ne doit arriver. Dans une économie planifiée, tout le génie humain serait dirigé vers le développement de vaccins contre les plus grandes maladies tueuses. Des programmes massifs d’immunisation seraient menés gratuitement dans chaque pays – éradiquant des maladies comme Ebola de la même manière qu’on l’a fait pour la variole. Les crises environnementales et les techniques d’élevage intensif, qui créent le contexte favorable pour les agents pathogènes, pourraient être remplacées par une production planifiée en harmonie avec la nature, ce qui accorderait la priorité au bien-être humain et animal par rapport au profit. Toute nouvelle épidémie virale pourrait être combattue par une réponse concertée et mondiale pour l’empêcher d’atteindre un niveau pandémique. Toute la recherche et les ressources pour le traitement pourraient être partagées et utilisées sur la base des besoins. Plutôt que d’avoir à se ruiner en faveur de compagnies pharmaceutiques privées, il serait possible d’exproprier leurs immenses avoirs et de les gérer sur une base démocratique pour produire des vaccins et des anticorps autant que nécessaire.
La médecine moderne représente une victoire phénoménale de la société sur la nature. Au moins dans les pays capitalistes avancés, elle a doublé l’espérance de vie et amélioré massivement la qualité de vie. Aucune société moderne incapable de garantir à sa population la santé et la protection contre des pandémies prévisibles ne peut être considérée civilisée. Là où les capitalistes et leurs suppôts traitent les urgences sanitaires en haussant les épaules et en informant les masses : « ceux que vous aimez vont mourir », une société socialiste équiperait l’humanité des armes dont elle a besoin dans la bataille contre la maladie. La réponse inhumaine et inepte des gouvernements capitalistes à la pandémie du COVID-19, et la faillite sociale qui en résulte, provoqueront un bond en avant de la conscience des masses. Déjà, il y a eu de nombreuses grèves spontanées en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, aux Etats-Unis, au Canada et ailleurs contre les tentatives par les patrons de forcer les travailleurs à choisir entre risquer l’infection à leur travail ou perdre leur salaire. Et ce n’est que le signe avant-coureur de ce qui est à venir. Nous entrons dans une nouvelle époque de lutte dramatique contre un système malade en phase terminale.
Théorie — de Fred Weston, ICR Grande-Bretagne — 18. 02. 2026
Amérique latine — de Flo Trummer, Zurich — 14. 02. 2026
Suisse — de Sereina Weber, Genève — 11. 02. 2026
Suisse — de Dersu Heri, Bern — 09. 02. 2026